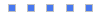

Avec un film d’épouvante en guise de critique sociale, Shindo Kaneto aura réussi à faire passer le message comme il le refera avec The Black Cat quatre ans plus tard, plus violent et toujours aussi étouffant : la pénombre dans ce dernier remplace les hautes herbes de Onibaba. A croire que le coup du film de genre pour dénoncer un système fonctionne à merveille, The Black Cat reprendra à peu de choses près les personnages de Onibaba (un samouraï, une jeune femme amoureuse et sa belle-mère) en changeant légèrement le profile de chacun. Ici la belle-mère refuse la liberté sexuelle de sa fille de peur d’être abandonnée, logique lorsque son fils, mort à la guerre, n’est plus là pour elle. Le personnage de la jeune fille démontre ici aussi des attitudes rebelles dues à son amour pour un samouraï, des attitudes freinées par la présence surréaliste d’un faux démon plus familier qu’elle ne pense. Le samouraï amoureux et digne de The Black Cat est ici remplacé par un homme sans tenue et sans cœur, désirant simplement tirer son coup pour satisfaire ses besoins primaires. Libre à chacun ensuite d’avoir un penchant pour un des deux films, mais il est tout à fait possible d’évoquer ici un certain jumelage entre les deux œuvres.
Onibaba met en tout cas beaucoup plus de temps pour démarrer. Après une demi-heure de métrage on se demande toujours où veut en venir Shindo Kaneto. Certes il est alors possible de couper court avec cette idée puisque certains grands films, exigeants, n’ont pas d’intérêt de prendre par la main le spectateur pour les emmener directement au but, mais l’introduction très longue de Onibaba lasse très rapidement avant de rebondir avec une vraie énergie lors de l’arrivée épouvantable d’un samouraï vêtu d’un masque de démon pour, dit-il, protéger son visage d’une incroyable beauté. Le mythe du faux-semblant, des esprits et démons ancestraux apporte alors à Onibaba le coup de fouet qu’il fallait pour atteindre de jolis petits sommets : la mise en scène appliquée de Shindo, offrant des jeux de lumière bluffant et des cadrages près des personnages, trouve alors une autre dimension, plus épouvantable encore. L’arrivée de ce personnage est le grand moment du film de par le mystère tournant autour de ce samouraï sorti de l’au-delà et de tout un tas de questions que le spectateur peut se poser : est-ce le fils de la belle-mère ? Est-ce l’esprit d’un des cadavres sortis du puit ? L’esprit un peu tordu pourra même imaginer une conclusion à la hauteur des meilleurs épisodes des Contes de la crypte.
Onibaba reste tout de même un film trop long et trop linéaire pour convaincre pleinement. La linéarité apporte parfois de belles choses au cinéma, comme une sorte de répétition qui basculerait dans la frénésie et qui mènerait, à coup sûr, vers un épilogue corsé. Mais le procédé utilisé pour certaines séquences (les courses de la jeune fille dans les hautes-herbes en pleine nuit notamment) est trop appuyé, usé, répétitif malgré un ensemble techniquement de très haute volée (Shindo signa notamment la direction artistique du film). Le spectateur patiente, longuement, pour enfin trouver des réponses à ses interrogations en fin de métrage dans un épilogue monstrueux au sens propre comme au sens figuré, véritable climax glaçant. Onibaba s’avère donc une réussite malgré les aprioris de départ, et malgré sa structure très linéaire, demeure original et presque marquant.


Avec Onibaba, Shindo Kaneto livre au travers d'un film plein d'épouvante et d'érotisme moite un violent commentaire politique sur la lutte des classes. Les seuls membres des classes aisées présents dans le film sont des samourais fuyant la guerre civile. Pour le reste, le film se concentre sur la lutte vitale des paysans. Le meurtre y est montré comme le seul moyen pour les pauvres de pouvoir se nourrir et survivre. Et leur instinct de survie trouve sa grande expression au travers de la sexualité vue comme un moyen pour la classe sociale paysanne de se perpétrer. Le no man's land dans lequel les personnages vivent (ces vastes champs ressemblant à une prison dont on ne peut s'échapper) évoque les ghettos et les bidonvilles isolés du reste du monde dans lesquels les exclus de la société s'entassent. Dès lors, les seules lois deviennent celles du plaisir et la survie. La mère refuse à sa belle-fille d'avoir une sexualité non par respect pour l'esprit de son fils défunt (l'amant de sa belle-fille est le meurtrier de ce dernier) mais par frustration de ne pas avoir accès à ce plaisir. Les armures de samourais passent du statut de symbole social à celui de simple objet à valeur marchande que l'on troque contre du riz. Les samourais sont montrés comme des etres n'ayant pas plus de repères moraux que leurs assassins. Shindo Kaneto se concentre ainsi sur la combattivité et l'envie de vivre du peuple dans une période troublée. Le film met d'ailleurs beaucoup de temps à devenir vraiment un film d'épouvante. L'épouvante naitra progressivement de la situation sociale des personnages ainsi que de la tension érotique du trio mère/belle-fille/amant dont les rivalités/fascinations sont exacerbées par la sécheresse. Chacun subira alors la cruelle vengeance du monde des esprits.

Mais Onibaba est aussi un magnifique festival formel et sonore. Le chocs des saxos free jazz et des percussions africaines nous plonge dans un monde du vaudou, du primitif, où l'instinct règne en maitre. Les champs créent des bruits oppressants lorsque les personnages s'y fraient un passage ou que le vent souffle sur eux. Chaque scène semble cadrée comme un tableau et Shindo fait un usage virtuose du scope. La course éperdue de la belle-fille vers son amant à travers les champs est l'occasion de travellings rapides reflétant la vivacité de son désir sexuel. La superbe photographie claire-obscure des scènes de nuit rend les apparitions des fantomes encore plus effroyables. L'utilisation de caméras portées dans les passages de la fin du film rendent bien la confusion mentale dans laquelle les personnages ont sombré.
En montrant comment la classe dominante met le peuple dans une situation de commettre des atrocités qui sont son seul moyen de vivre décemment, Shindo Kaneto livrait une vision de la société fondée sur le rapport de force qui pousse les faibles à la faute et à la transgression des lois morales. Mais il faisait passer cette vision d'autant plus efficacement qu'elle était dissimulée dans les chevaux de troie de l'érotisme et de l'effroi. A l'instar d'un Fukasaku à la meme époque, il prouvait ainsi que le cinéma de genre était le moyen le plus efficace de faire du cinéma social sans tomber dans la lourdeur démonstrative.

 Un abri de fortune perdu dans un champ, des plantes qui ont la hauteur d’un être humain et qui sont balayées par les vents, un endroit hors du temps, en marge des évènements, qui, bien que situé à l’époque des samouraïs, a une portée universelle, 2 sauvageonnes qui survivent par le meurtre et le troc, qui survivent l’une grâce à l’autre et vice-versa, dont les sentiments et les sensations sont à fleur de peau, quasi-bestiaux, et qui se battent pour 1 même homme… Onibaba est un rêve éveillé, plongé dans un noir et blanc hallucinant de beauté, doté d’une mise en scène à couper le souffle et servi par 2 magnifiques actrices qui se livrent à la caméra avec un naturel et une conviction bluffante. Shindo est décidément un réalisateur marquant des années 50 et 60 qui gagne à être découvert.
Un abri de fortune perdu dans un champ, des plantes qui ont la hauteur d’un être humain et qui sont balayées par les vents, un endroit hors du temps, en marge des évènements, qui, bien que situé à l’époque des samouraïs, a une portée universelle, 2 sauvageonnes qui survivent par le meurtre et le troc, qui survivent l’une grâce à l’autre et vice-versa, dont les sentiments et les sensations sont à fleur de peau, quasi-bestiaux, et qui se battent pour 1 même homme… Onibaba est un rêve éveillé, plongé dans un noir et blanc hallucinant de beauté, doté d’une mise en scène à couper le souffle et servi par 2 magnifiques actrices qui se livrent à la caméra avec un naturel et une conviction bluffante. Shindo est décidément un réalisateur marquant des années 50 et 60 qui gagne à être découvert.

 Quatre ans après le succès de L'île nue qui renfloua les caisses de son studio, la compagnie indépendante Kindai Eiga Kyokai, Shindo frappe encore très fort, Shindo est l'incarnation même de la puissance dépouillée au cinéma, Shindo est un dieu du 7ème art ! ^^
Quatre ans après le succès de L'île nue qui renfloua les caisses de son studio, la compagnie indépendante Kindai Eiga Kyokai, Shindo frappe encore très fort, Shindo est l'incarnation même de la puissance dépouillée au cinéma, Shindo est un dieu du 7ème art ! ^^
 Ce qu'il y a de formidable avec Kaneto Shindo, c'est ce don pour une histoire de rien du tout traitée comme une vague qui n'explose définitivement qu'à la dernière image et ne prend tout son sens qu'une fois retirée, comme un art parfait de la répétition, du cycle immuable de vies simples, une impression répétitive que le film ne va mener à rien et que tout cela n'a pas grand intérêt et soudain, avec autant de répétitions, un acte minuscule, un évènement minime qui vient piquer la cérémonie trop bien installée pour durer et fait finalement s'envoler une force brute terrassante d'humanisme, comme une simple brise libre et hasardeuse qui souffle constamment dans les roseaux bien enracinés sans jamais créer le même mouvement, image clef du film. Pas très clair peut-être mais ce n'est pas grave. Disons que là où l'ennui semble arriver tellement tout cela semble immuable, inutile et sans conséquence, comme dans l'île nue, c'est juste à ce moment que Shindo souffle un grand coup pour transmettre d'autant plus fort ses messages sociaux essentiels et rendre beau des personnages oubliés de la société, comme le ferait un Dode's Kaden féodal centré sur un trio, avec une touche de superstition démoniaque en plus, avec le même art minimaliste d'imbriquer naturellement humour subtil, fable sociale et atmosphère tendue, et dans le cas présent ne tendant que tardivement vers une tension horrifique.
Ce qu'il y a de formidable avec Kaneto Shindo, c'est ce don pour une histoire de rien du tout traitée comme une vague qui n'explose définitivement qu'à la dernière image et ne prend tout son sens qu'une fois retirée, comme un art parfait de la répétition, du cycle immuable de vies simples, une impression répétitive que le film ne va mener à rien et que tout cela n'a pas grand intérêt et soudain, avec autant de répétitions, un acte minuscule, un évènement minime qui vient piquer la cérémonie trop bien installée pour durer et fait finalement s'envoler une force brute terrassante d'humanisme, comme une simple brise libre et hasardeuse qui souffle constamment dans les roseaux bien enracinés sans jamais créer le même mouvement, image clef du film. Pas très clair peut-être mais ce n'est pas grave. Disons que là où l'ennui semble arriver tellement tout cela semble immuable, inutile et sans conséquence, comme dans l'île nue, c'est juste à ce moment que Shindo souffle un grand coup pour transmettre d'autant plus fort ses messages sociaux essentiels et rendre beau des personnages oubliés de la société, comme le ferait un Dode's Kaden féodal centré sur un trio, avec une touche de superstition démoniaque en plus, avec le même art minimaliste d'imbriquer naturellement humour subtil, fable sociale et atmosphère tendue, et dans le cas présent ne tendant que tardivement vers une tension horrifique.
Trois acteurs principaux donc, un duo de femmes reclu dans une hutte de fortune bien dissimulée à l'écart de la guerre qui fait rage, la vieille "sorcière" possessive Nobuko Otowa fascinante de présence, compagnon de travail de Kaneto pendant plus de 40 ans et mariée à celui-ci seulement à 60 ans, avec une relation officieuse certainement plus vieille, Jitsuko Yoshimura, sa belle fille (dans le film ;)), en sublime sauvageonne pas vraiment fûtée mais bien décidée à obtenir sa dose de sexe journalière, et finalement un Kei Sato croustillant qui joue une fainéasse revenue on ne sait comment de la guerre, résidant à quelques centaines de mètres des deux filles, un peu plus expérimenté en affaires mais franchement bas de plafond lui aussi, enclin même à piquer des sublimes crises de nerfs solitaires (allez, va courir et crier dans les roseaux), et donc très attachant, et tout aussi décidé à sa dose journalière. Un trio qui s'attire et se déchire, une petite histoire simple mais diablement porteuse mine de rien, surtout à la vue de la puissance formelle qui surnage.
 Car que ce soit la musique ambient tribale d'Ikari Hayashi, le son, la mise en scène, l'image, la photo ou simplement l'utilisation du noir et blanc, n'en parlons pas, c'est du grand art. Chaque plan est absolument magnifique, travaillé à l'extrême, dépouillé, simple, naturel et puissant. Quelle belle image que ce travelling vertical sur cet arbre mort, sorte d'énorme sexe géant raci et antagonisme du roseau souple et libre, quel art du gros plan fascinant, quelle maîtrise de ces courses à répétition dans les roseaux, une envie de liberté et par la même occasion une odeur comique plus proche encore de la réjouissance, quel trou signifiant, personnage à part entière, quel masque terrible, objet du châtiment surpuissant de symbolisme, ***spoiler*** l'égarement de l'âme et la capture de la beauté, l'objet sacrée dont on abuse et qui se retourne contre soit comme un écho lointain au Portrait de Dorian Gray ***spoiler***, et finalement, quel final halllucinant de force brute !
Car que ce soit la musique ambient tribale d'Ikari Hayashi, le son, la mise en scène, l'image, la photo ou simplement l'utilisation du noir et blanc, n'en parlons pas, c'est du grand art. Chaque plan est absolument magnifique, travaillé à l'extrême, dépouillé, simple, naturel et puissant. Quelle belle image que ce travelling vertical sur cet arbre mort, sorte d'énorme sexe géant raci et antagonisme du roseau souple et libre, quel art du gros plan fascinant, quelle maîtrise de ces courses à répétition dans les roseaux, une envie de liberté et par la même occasion une odeur comique plus proche encore de la réjouissance, quel trou signifiant, personnage à part entière, quel masque terrible, objet du châtiment surpuissant de symbolisme, ***spoiler*** l'égarement de l'âme et la capture de la beauté, l'objet sacrée dont on abuse et qui se retourne contre soit comme un écho lointain au Portrait de Dorian Gray ***spoiler***, et finalement, quel final halllucinant de force brute !
Un autre ! Un autre !
(1) Schaffner s'est inspiré de l'ouverture d'Onibaba tant dans la mise en scène que dans la musique pour sa fameuse scène de chasse de La Planète des singes, c'est pas possible !
(2) Jean-Jacques Annaud s'est inspiré de ses marécages invivables où la survie se résume à manger chaud et assouvir ses besoins sexuels pour sa Guerre du feu, c'est pas possible !