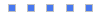

| Tenebres83 | 2.75 | |
| Xavier Chanoine | 2 | Une forme intéressante mais un contenu trop limité |
 Un an après avoir fondé sa propre société de production Wakamatsu Pro., le troublant réalisateur du réputé L'extase des anges signe un film aux antipodes mêmes du film de studio traditionnel. Dans une époque où les cinéastes de la nouvelle vague émergent (Oshima Nagisa) et confirment (Masumura), Wakamatsu tire son épingle du lot par sa représentation de la violence extrêmement crue sans pour autant être dénonciatrice, puisque ses films plus politiques, scénarisés par son collaborateur et ami Adachi Masao ne viendront que plus tard. Avec Quand l'embryon part braconner, le cinéaste reste dans le cadre fermé du rapport employeur/employée et opte pour une oeuvre à huit clos (ce qui est et sera sa marque de fabrique), entièrement tournée en noir et blanc afin d'immerger le spectateur dans un endroit plus étouffant qu'il ne l'est déjà et l'on peut dire que le résultat est plutôt concluant dans un registre purement formel. Le film joue aussi de ses excès et contrastes, débutant sous des coeurs religieux pour virer de suite à une scène d'amour en voiture entre Sadao et Yuka, une jeune femme en flirt. Attirée, cette dernière décide d'accompagner Sadao dans son appartement sans savoir que ce dernier est sur le point de préparer un véritable rituel SM. Le film semble partir sur de bonnes bases, notamment grâce à l'utilisation d'une musique légère aux instrumentations rappelant celles des films expérimentaux d'Oshima (Le Journal d'un Voleur de Shinjuku, Il est mort après la guerre). Wakamatsu instaure de ce fait immédiatement une atmosphère délirante où jeux SM d'une violence inouïe, primaire, malsaine côtoient un filmage d'une grande précision, où splitscreen et cadrages serrés font bon ménage. Cette mixité entre une violence de base et un filmage artisanal proche de l'expérimental étonne plus qu'il ne rassure, la faute à une relative répétitivité des séquences porno soft.
Un an après avoir fondé sa propre société de production Wakamatsu Pro., le troublant réalisateur du réputé L'extase des anges signe un film aux antipodes mêmes du film de studio traditionnel. Dans une époque où les cinéastes de la nouvelle vague émergent (Oshima Nagisa) et confirment (Masumura), Wakamatsu tire son épingle du lot par sa représentation de la violence extrêmement crue sans pour autant être dénonciatrice, puisque ses films plus politiques, scénarisés par son collaborateur et ami Adachi Masao ne viendront que plus tard. Avec Quand l'embryon part braconner, le cinéaste reste dans le cadre fermé du rapport employeur/employée et opte pour une oeuvre à huit clos (ce qui est et sera sa marque de fabrique), entièrement tournée en noir et blanc afin d'immerger le spectateur dans un endroit plus étouffant qu'il ne l'est déjà et l'on peut dire que le résultat est plutôt concluant dans un registre purement formel. Le film joue aussi de ses excès et contrastes, débutant sous des coeurs religieux pour virer de suite à une scène d'amour en voiture entre Sadao et Yuka, une jeune femme en flirt. Attirée, cette dernière décide d'accompagner Sadao dans son appartement sans savoir que ce dernier est sur le point de préparer un véritable rituel SM. Le film semble partir sur de bonnes bases, notamment grâce à l'utilisation d'une musique légère aux instrumentations rappelant celles des films expérimentaux d'Oshima (Le Journal d'un Voleur de Shinjuku, Il est mort après la guerre). Wakamatsu instaure de ce fait immédiatement une atmosphère délirante où jeux SM d'une violence inouïe, primaire, malsaine côtoient un filmage d'une grande précision, où splitscreen et cadrages serrés font bon ménage. Cette mixité entre une violence de base et un filmage artisanal proche de l'expérimental étonne plus qu'il ne rassure, la faute à une relative répétitivité des séquences porno soft.Cette répétitivité, on la doit au scénariste Adachi Masao, réputé comme créateur de scripts incompréhensibles dixit Wakamatsu, obligé de refuser le premier travail proposé par Adachi notamment à cause d'une poignée de séquences hors sujet. Adachi avait d'ailleurs été recruté par Wakamatsu des suites de la projection de son premier film en 1963, qu'il jugeait déjà incompréhensible mais intéressant en bien des points. Et l'on sent ici les limites du scénariste, trop calqué sur une succession guère justifiée de séquences mettant en scène Sadao entrain de maltraiter la pauvre Yuka, armé de son fouet. Si Sadao représente un personnage décalé et anarchiste, ses propos manquent de cohérence et de consistance. Incapable de se reprendre en main, il humilie son hôte par ses coups à répétition et ses noms d'oiseaux qu'on ne compte plus, sous prétexte que cette dernière ressemble à son ex-femme qu'il méprise. Cette thérapie sadomasochiste confronte Sadao à ses vieux démons, la haine qu'il voue à sa mère responsable de sa naissance "Pourquoi suis-je né? mais aussi son refus catégorique d'avoir des enfants, un phénomène encore d'actualité prouvant que Wakamatsu était en quelque sorte avant-gardiste dans ses propos. Mais cette critique appuyée de l'être humain manque une fois de plus de consistance, Sadao insistant sur le fait que toutes les femmes sont des "sacs à merde" et des "chiennes". Lassant, bien que le cinéaste parvienne par l'utilisation de procédés narratifs et visuels réussis à instaurer un climat d'insécurité permanent car dans la logique les intérieurs représentent le foyer, la sécurité, démontrés ici par Wakamatsu comme pires que les inquiétants et sombres extérieurs.
 Le rapport bourreau/victime tend aussi à la relation père/fille, dans une séquence enragée où Sadao projette de refaire l'éducation de Yuka, mais à coups de fouet. Mais dans l'ensemble, la critique sociale manque de mordant, Wakamatsu retombant dans les travers de son cinéma érotique déluré où une musique festive peut rythmer les coups de fouet, à défaut que l'utilisation d'un tel procédé ironique sera davantage maîtrisé par Kubrick dans Orange Mécanique, et ce à tous les niveaux. Au fur et à mesure que le film progresse, le bourreau devient victime et vis versa, ce qui a le mérite d'apporter un rebondissement que l'on attendait certes peut-être mais qui se révèle au final plutôt bien maîtrisé : Yuka est traitée comme une chienne et réagira comme une chienne, à quatre pattes, presque la bave aux lèvres. La représentation du côté bestial de l'Homme est alors cohérente et bien imagée. Mais soyons francs, la représentation obsédante et terrorisante du sexe est plus intéressante chez Masumura dans La Bête Aveugle, et le grotesque des tortures vaut plus le détour chez Pasolini dans Salo, Wakamatsu, lui, restant trop à l'écart la faute à un scénario peu approfondi malgré une forme d'une grande maîtrise. Les intérieurs sont filmés comme une prison où l'échappatoire n'est pas possible, matérialisée par l'absence totale de plans filmés en extérieur une fois les dix premières minutes passées. Cette absence de conformisme et de bon goût fera la réputation de Wakamatsu. N'y cherchons pas de grandes confrontations politiques, l'heure n'y est pas encore. On y trouve uniquement un obscur huit clos SM, paradoxalement trop long du fait de tortures infiniment trop étirées sur la longueur, d'une direction d'acteurs très limitée et d'un manque cinglant de matière. Toujours est-il que l'amateur de pinku dark y trouvera sûrement son compte...
Le rapport bourreau/victime tend aussi à la relation père/fille, dans une séquence enragée où Sadao projette de refaire l'éducation de Yuka, mais à coups de fouet. Mais dans l'ensemble, la critique sociale manque de mordant, Wakamatsu retombant dans les travers de son cinéma érotique déluré où une musique festive peut rythmer les coups de fouet, à défaut que l'utilisation d'un tel procédé ironique sera davantage maîtrisé par Kubrick dans Orange Mécanique, et ce à tous les niveaux. Au fur et à mesure que le film progresse, le bourreau devient victime et vis versa, ce qui a le mérite d'apporter un rebondissement que l'on attendait certes peut-être mais qui se révèle au final plutôt bien maîtrisé : Yuka est traitée comme une chienne et réagira comme une chienne, à quatre pattes, presque la bave aux lèvres. La représentation du côté bestial de l'Homme est alors cohérente et bien imagée. Mais soyons francs, la représentation obsédante et terrorisante du sexe est plus intéressante chez Masumura dans La Bête Aveugle, et le grotesque des tortures vaut plus le détour chez Pasolini dans Salo, Wakamatsu, lui, restant trop à l'écart la faute à un scénario peu approfondi malgré une forme d'une grande maîtrise. Les intérieurs sont filmés comme une prison où l'échappatoire n'est pas possible, matérialisée par l'absence totale de plans filmés en extérieur une fois les dix premières minutes passées. Cette absence de conformisme et de bon goût fera la réputation de Wakamatsu. N'y cherchons pas de grandes confrontations politiques, l'heure n'y est pas encore. On y trouve uniquement un obscur huit clos SM, paradoxalement trop long du fait de tortures infiniment trop étirées sur la longueur, d'une direction d'acteurs très limitée et d'un manque cinglant de matière. Toujours est-il que l'amateur de pinku dark y trouvera sûrement son compte...


