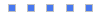

| drélium | 5  |
Escargot suprême. |
| El Topo | 5  |
La perfection ? |
| Ghost Dog | 3.75  |
1 sur 4 |
| Ordell Robbie | 5  |
Un must du cinéma fantastique |
| Sonatine | 5  |
Sans commentaires. |
| Xavier Chanoine | 4.25 | Spectacle majestueux |

 Quatre histoires de fantômes japonais, Kobayashi aux commandes, 1 million de dollars de budget, un film légendaire et colossal qu'il me tardait de découvrir depuis si longtemps, et la perfection pure et simple est au rendez-vous. Kwaidan est évidemment très, très lent ce qui semble normal pour un Kobayashi mais là c'est définitivement le cas. Cependant, une lenteur très loin d'être surfaite et inutile, une lenteur captivante, là est toute la différence. Kwaidan raconte quatre fâbles aux scénarios sympathiques mais qui ne font certainement pas la force du chef d'oeuvre absolu. Kwaidan est sans conteste l'ancêtre luxueux et féodal des Ring et autres Bake Mono "Sadakesque", une lenteur oppressante donc, un nombre de personnages restreint, un ou des fantômes mystérieux, une ambiance sonore capitale et un climat de peur plus sensoriel que démonstratif. Oui mais là où Ring et les autres enfants du genre sont juste honnêtes, Kwaidan est d'une puissance magique incommensurable.
Quatre histoires de fantômes japonais, Kobayashi aux commandes, 1 million de dollars de budget, un film légendaire et colossal qu'il me tardait de découvrir depuis si longtemps, et la perfection pure et simple est au rendez-vous. Kwaidan est évidemment très, très lent ce qui semble normal pour un Kobayashi mais là c'est définitivement le cas. Cependant, une lenteur très loin d'être surfaite et inutile, une lenteur captivante, là est toute la différence. Kwaidan raconte quatre fâbles aux scénarios sympathiques mais qui ne font certainement pas la force du chef d'oeuvre absolu. Kwaidan est sans conteste l'ancêtre luxueux et féodal des Ring et autres Bake Mono "Sadakesque", une lenteur oppressante donc, un nombre de personnages restreint, un ou des fantômes mystérieux, une ambiance sonore capitale et un climat de peur plus sensoriel que démonstratif. Oui mais là où Ring et les autres enfants du genre sont juste honnêtes, Kwaidan est d'une puissance magique incommensurable.
 La cohésion de l'ensemble tout d'abord relève du génie (comme tout le reste). Les deux premières histoires assez proches l'une de l'autre servent d'encas de luxe où l'ambiance visuelle et sonore fait des merveilles pour se plonger progressivement dans le bain. Peu de dialogues dans ces deux encas mais une lente pression glacée crescendo comme jamais, un ressenti puissant et constant qu'il va se passer quelque chose de terrible. Le troisième segment, gros morceau d'une heure, est le plat de résistance, pas tant pour cette onirique bataille surréaliste et théâtrale en pleine mer, déjà superbe et magnifiquement placée, que plus encore pour ce qui suivra, là où nous emmènera le joueur de Luth, avec une petite dose d'humour, grâce à Kunie Tanaka, absente des deux premières histoires qui leste un peu la pression et complète le sensoriel. Le dernier segment pour finir, parfaite conclusion au tout, épilogue à l'esthétisme sobre, libère encore un brin de pression, grâce à un penchant ludique supplémentaire et une dose accrue de mouvements désordonnés, comme un spectateur qui se débattrait de la toile fantômatique, pour terminer sur un ultime plan glacial.
La cohésion de l'ensemble tout d'abord relève du génie (comme tout le reste). Les deux premières histoires assez proches l'une de l'autre servent d'encas de luxe où l'ambiance visuelle et sonore fait des merveilles pour se plonger progressivement dans le bain. Peu de dialogues dans ces deux encas mais une lente pression glacée crescendo comme jamais, un ressenti puissant et constant qu'il va se passer quelque chose de terrible. Le troisième segment, gros morceau d'une heure, est le plat de résistance, pas tant pour cette onirique bataille surréaliste et théâtrale en pleine mer, déjà superbe et magnifiquement placée, que plus encore pour ce qui suivra, là où nous emmènera le joueur de Luth, avec une petite dose d'humour, grâce à Kunie Tanaka, absente des deux premières histoires qui leste un peu la pression et complète le sensoriel. Le dernier segment pour finir, parfaite conclusion au tout, épilogue à l'esthétisme sobre, libère encore un brin de pression, grâce à un penchant ludique supplémentaire et une dose accrue de mouvements désordonnés, comme un spectateur qui se débattrait de la toile fantômatique, pour terminer sur un ultime plan glacial.
 Que ce soit la maison qui se décrépit discrètement plan après plan, la terrible femme des neiges, la présence flamboyante du clan Heike trépassé entre brume et réalité, le visage mi angélique, mi infernal habitant dans le bol de thé et une tonne d'autres claques encore, Kwaidan reste gravé pour longtemps et en profondeur. Alchimie grandiose d'une sublime ambiance sonore expérimentale, de décors fabuleux composés de main de maître, de couleurs à tomber par terre, d'une image époustouflante de densité, d'un cast parfait et ce pour chaque segment, tous sans exception complètement hypnotiques ; tout en fait relève de l'hypnose globale ou la lenteur extrême est partie entière de la potion euphorisante et glaciale à la fois. Impression unique de palper, sentir, ressentir le bois et le tissu, la neige et l'osier, la mer, la terre et la brume, le thé et le papier, Kwaidan, c'est avant tout une expérience sensorielle suprême où ces petits détails ne font que renforcer la traversée, le voyage que l'on souhaiterait ne jamais finir. Une tension fantastique énorme, des travellings flottants, une contenance millimétrée retenue jusqu'à l'ultime frontière, des êtres et des sons qui errent entre les dimensions, des transformations de l'espace, soit par touches subtiles d'un plan à l'autre, soit simplement par la lumière, un traitement visuel au dessus de tout. Bref, Kwaidan, c'est inexplicable tant c'est maîtrisé et bien plus que cela, majestueux, et ce dans absolument tous les compartiments, comme un goût prononcé d'avoir vu l'Olympe.
Que ce soit la maison qui se décrépit discrètement plan après plan, la terrible femme des neiges, la présence flamboyante du clan Heike trépassé entre brume et réalité, le visage mi angélique, mi infernal habitant dans le bol de thé et une tonne d'autres claques encore, Kwaidan reste gravé pour longtemps et en profondeur. Alchimie grandiose d'une sublime ambiance sonore expérimentale, de décors fabuleux composés de main de maître, de couleurs à tomber par terre, d'une image époustouflante de densité, d'un cast parfait et ce pour chaque segment, tous sans exception complètement hypnotiques ; tout en fait relève de l'hypnose globale ou la lenteur extrême est partie entière de la potion euphorisante et glaciale à la fois. Impression unique de palper, sentir, ressentir le bois et le tissu, la neige et l'osier, la mer, la terre et la brume, le thé et le papier, Kwaidan, c'est avant tout une expérience sensorielle suprême où ces petits détails ne font que renforcer la traversée, le voyage que l'on souhaiterait ne jamais finir. Une tension fantastique énorme, des travellings flottants, une contenance millimétrée retenue jusqu'à l'ultime frontière, des êtres et des sons qui errent entre les dimensions, des transformations de l'espace, soit par touches subtiles d'un plan à l'autre, soit simplement par la lumière, un traitement visuel au dessus de tout. Bref, Kwaidan, c'est inexplicable tant c'est maîtrisé et bien plus que cela, majestueux, et ce dans absolument tous les compartiments, comme un goût prononcé d'avoir vu l'Olympe.

 Avec l’immense Kobayashi Masaki à la réalisation, un casting haut de gamme (Kishi Keiko, Tamba Tetsuro, Nakadai Tatsuya…excusez du peu), un score légendaire de Takemitsu Toru, un développement qui s’étala sur une décennie, un tournage qui dura plus d’un an, le plus gros budget de son époque pour un film de l’archipel nippon (350 millions de yen), un grand prix du jury à Cannes ( en 1965) et une réputation éminemment flatteuse, Kwaïdan offre toutes les promesses d’un très grand film, un chef d’œuvre. Et en réalité, il est même bien plus que ça...
Avec l’immense Kobayashi Masaki à la réalisation, un casting haut de gamme (Kishi Keiko, Tamba Tetsuro, Nakadai Tatsuya…excusez du peu), un score légendaire de Takemitsu Toru, un développement qui s’étala sur une décennie, un tournage qui dura plus d’un an, le plus gros budget de son époque pour un film de l’archipel nippon (350 millions de yen), un grand prix du jury à Cannes ( en 1965) et une réputation éminemment flatteuse, Kwaïdan offre toutes les promesses d’un très grand film, un chef d’œuvre. Et en réalité, il est même bien plus que ça...
Dans Kwaïdan, Kobayashi met en scène quatre histoires de fantômes tirées des écrits de Lafcadio Hearn, quatre contes moraux et surnaturels qui permettent chacun de penser que le réalisateur de la Condition de l'Homme et Seppuku a découvert et su extraire la quintessence du Sublime pour mieux la distiller sur ces quelques trois heures de bonheur féerique qui constituent son film. Jamais dans le cinéma en couleur, on ne s’était approché à ce point de la perfection picturale. Le festival des teintes magiques de l’œuvre, orchestré par une photographie divine et des décors somptueux, peints par Kobayashi lui-même (avant d’étudier la philosophie et de devenir adjoint de Kinoshita Keisuke ce qui est déjà une école de l’art en soi, le réalisateur de Rebellion avait été artiste-peintre) rend presque secondaire le récit pourtant envoûtant des quatre histoires. Presque car malgré l’indicible charme qu’exerce l’esthétique du film sur le spectateur, on ne peut qu’être subjugué par la succession de ces fables merveilleuses (même si le premier segment souffre de la comparaison avec Les Contes de la Lune Vague après la Pluie de Mizoguchi Kenji, qu’il évoque irrésistiblement) jusqu’à atteindre une forme de sommet avec l’histoire principale (qui est aussi la plus longue avec un peu plus d’une heure de délices cinématographiques au compteur), Hoichi-sans-oreilles qui relate l’aventure d’un jeune joueur de biwa (une sorte de luth) aveugle qu’un esprit emmène chaque soir pour chanter à son maître et sa cour le combat qui les vit chuter (cette bataille navale au traitement quasi-impressionniste qui ouvre le conte est une fois de plus un bijou et vaut à elle seule que l’on voit le film). Et malgré ce « climax avant l’heure » l’ensemble conserve une remarquable homogénéité, celle-ci étant due à une incroyable constance dans l’excellence. Il n’est d’ailleurs nul besoin des traditionnelles transitions inhérentes au découpage d’un film en plusieurs « sketchs » : pourquoi chercher un quelconque liant entre les différentes parties puisqu’il suffit qu’une s’achève pour que l’on en veuille encore, toujours plus tant cet enchantement coloré et délicieux captive l’œil, l’esprit, le coeur… Mais que dire de plus de Kwaïdan sans répéter inlassablement qui si la perfection esthétique n’est pas de ce monde, le film de Kobayashi est assurément l’exception qui confirme cette règle péremptoire.

 De loin le segment le plus abouti, le plus beau visuellement et thématiquement, le plus mystérieux. Il dure d'alleurs plus d'une heure, ce qui en fait l'histoire centrale, celle qui à elle seule fait que Kwaidan vaut largement le détour et mérite de rentrer dans les annales du Cinéma. Il y a ce temple perdu au bord de la mer, ces chansons accompagnées au luth, ce jeune aveugle utilisé par des fantômes, cette séance ultime de soutras peints sur le corps (qui a inspiré The Pillow Book?), et ce magnifique moment de rencontre entre le samourai fantôme et Hoichi. Kobayashi nous laisse véritablement sur le cul avec ce moyen métrage.
De loin le segment le plus abouti, le plus beau visuellement et thématiquement, le plus mystérieux. Il dure d'alleurs plus d'une heure, ce qui en fait l'histoire centrale, celle qui à elle seule fait que Kwaidan vaut largement le détour et mérite de rentrer dans les annales du Cinéma. Il y a ce temple perdu au bord de la mer, ces chansons accompagnées au luth, ce jeune aveugle utilisé par des fantômes, cette séance ultime de soutras peints sur le corps (qui a inspiré The Pillow Book?), et ce magnifique moment de rencontre entre le samourai fantôme et Hoichi. Kobayashi nous laisse véritablement sur le cul avec ce moyen métrage.
 Avec Kwaidan adapté d'une série de nouvelles de l'écrivain Lafcadio Hearn, Kobayashi réussit quelque chose d'assez rare dans le film à sketches -les 3 Visages de la Peur de Mario Bava sont un autre exemple de ce genre de réussite-, à savoir offrir quatre histoires à peu près égales en terme de qualité et d'impact. Si la présence au générique de Mikuni Rentaro et NAKADAI Tatsuya, du compositeur Takemitsu Toru (Ran et la Femme des Sables entre autres) ne vous ont pas convaincu et si vous n'avez pas déjà vu d'autres films de cet immense cinéaste, on pourrait rajouter que le film a fortement influencé esthétiquement le Dracula de Coppola et que des dénommés Lucas, Spielberg, Milius, Scorcese le comptent parmi leurs films japonais de chevet, qu'il en est de même d'un dénommé Gans. Toujours pas convaincus? Alors lisez ce qui suit...
Avec Kwaidan adapté d'une série de nouvelles de l'écrivain Lafcadio Hearn, Kobayashi réussit quelque chose d'assez rare dans le film à sketches -les 3 Visages de la Peur de Mario Bava sont un autre exemple de ce genre de réussite-, à savoir offrir quatre histoires à peu près égales en terme de qualité et d'impact. Si la présence au générique de Mikuni Rentaro et NAKADAI Tatsuya, du compositeur Takemitsu Toru (Ran et la Femme des Sables entre autres) ne vous ont pas convaincu et si vous n'avez pas déjà vu d'autres films de cet immense cinéaste, on pourrait rajouter que le film a fortement influencé esthétiquement le Dracula de Coppola et que des dénommés Lucas, Spielberg, Milius, Scorcese le comptent parmi leurs films japonais de chevet, qu'il en est de même d'un dénommé Gans. Toujours pas convaincus? Alors lisez ce qui suit...
the Black Hair: Dans ce premier sketche, un samouraï ruiné quitte sa femme parce qu'il a l'opportunité d'épouser une femme plus élevée dans l'échelon social. Au fur et à mesure des années, il se met à regretter sa décision égoïste et une fois libéré de ses obligations il décide de retourner à la maison désormais en ruines de son ex-femme. Il la retrouve toujours aussi jeune et désireuse de lui pardonner. Je n'en dis pas plus pour ne pas gâcher le coup de théâtre final.
The Woman of the Snow: Au cours d'une expédition en montagne, deux hommes sont surpris par un blizzard. Le plus jeune voit une fantôme tuer avec son souffle le plus âgé des deux. Elle décide de l'épargner tout en le menaçant de le faire si il révèle un jour à un autre ce qui s'est passé cette nuit-là. Entre temps, le jeune homme se marie avec une femme enviée de tous à cause de son visage éternellement jeune. Mais un jour il faillit à sa promesse en lui révélant ce qui s'est passé ce soir-là...
Hoichi the Earless: Ce sketche fait partie des sommets du film, long hypnotique, quasi-surréaliste. Hoichi, un moine qui est aussi un musicien aveugle, chante des batailles de samouraïs qui suscitent l'intérêt d'un étranger. Ce dernier lui propose de l'accompagner chez lui pour jouer ses chansons à condition de ne dire à personne où il va. Il joue en fait dans un cimmetière pour les esprits dont il chante les exploits. Réalisant cela, un collègue moine décide de peindre les textes sacrés sur Hoichi pour le protéger mais oublie de peindre ses oreilles...
In a Cup of Tea: Ce dernier sketche conclut le film de façon surprenante car il ne s'interroge sur rien de moins que le rapport d'un artiste à ses créations et comment elles peuvent parfois se retourner contre lui. Un écrivain compose l'histoire suivante: un samouraï boit du thé et voit dans la tasse le reflet d'un fantôme puis de trois samouraïs. Il se retrouve hôte du premier fantôme puis obligé de combattre les trois samouraïs qui disparaissent et réapparaissent au cours d'une séquence hallucinante. Mais l'écrivain va se retrouver victime de sa création au cours d'un final soufflant.
 La grande force de Kwaidan est d'être somptueux visuellement sans pour autant sombrer dans l'exotisme festivalier. Certes, chaque plan est composé et cadré comme une toile de maître -surtout que Kobayashi lui-même a peint les décors et que ce projet mûri dix ans durant a nécessité un an de tournage, en faisant le film japonais le plus cher à l'époque-, les costumes sont somptueux. Mais cette beauté n'est là que pour contraster avec le caractère glaçant de ce qui se passe à l'écran. C'est cette tension renforcée par l'aspect étrange et répétitif du score de Takemitsu Toru qui fait tout le prix du film. On pourrait également croire qu'il s'agit d'une oeuvre moins personnelle que les chambaras ou les fresques guerrières qui ont fait la réputation de Kobayashi mais le cinéaste y poursuit d'une autre manière la réflexion sur le caractère trompeur des apparences: dans Hara Kiri et Rebellion, la barbarie et la cruauté étaient l'envers du code d'honneur des samouraïs; dans la Condition de l'Homme, Russes, Chinois, Japonais, chefs de camps comme prisonniers de guerre avaient chacun leur part de cruauté; ici, cette tension entre ce que l'on croit voir et ce qui se passe effectivement parcourt le film dans son ensemble (surtout que les êtres les plus cruels du film ne sont pas les fantômes mais des humains piégés par leur avidité). Kwaidan est donc plus personnel qu'il n'y paraît ce qui le rend d'autant plus précieux.
La grande force de Kwaidan est d'être somptueux visuellement sans pour autant sombrer dans l'exotisme festivalier. Certes, chaque plan est composé et cadré comme une toile de maître -surtout que Kobayashi lui-même a peint les décors et que ce projet mûri dix ans durant a nécessité un an de tournage, en faisant le film japonais le plus cher à l'époque-, les costumes sont somptueux. Mais cette beauté n'est là que pour contraster avec le caractère glaçant de ce qui se passe à l'écran. C'est cette tension renforcée par l'aspect étrange et répétitif du score de Takemitsu Toru qui fait tout le prix du film. On pourrait également croire qu'il s'agit d'une oeuvre moins personnelle que les chambaras ou les fresques guerrières qui ont fait la réputation de Kobayashi mais le cinéaste y poursuit d'une autre manière la réflexion sur le caractère trompeur des apparences: dans Hara Kiri et Rebellion, la barbarie et la cruauté étaient l'envers du code d'honneur des samouraïs; dans la Condition de l'Homme, Russes, Chinois, Japonais, chefs de camps comme prisonniers de guerre avaient chacun leur part de cruauté; ici, cette tension entre ce que l'on croit voir et ce qui se passe effectivement parcourt le film dans son ensemble (surtout que les êtres les plus cruels du film ne sont pas les fantômes mais des humains piégés par leur avidité). Kwaidan est donc plus personnel qu'il n'y paraît ce qui le rend d'autant plus précieux.
 S'inscrivant dans le registre particulier du film à sketchs, Kwaidan marqua l'Histoire du cinéma japonais par ses thématiques abordées et son sens aigu de la mise en scène. Récit décousu en quatre histoires différentes, l'accent est mis sur la contemplation au détriment d'une recherche de l'action et de scénarii qui auraient pu gagner en égalité. Kobayashi nous invite avec le premier épisode, Les cheveux noirs à prendre place au sein des différents foyers visités par un homme en plein doute sentimental, visités par ce dernier, lequel finira par revenir en son foyer initial pour reconquérir le coeur de son épouse qui l'attend depuis des mois. Sous ses attraits purement fantastiques, le cinéaste change littéralement de ton, laissant le côté contemplatif et narratif de côté pour une plongée terrifiante dans la mort et l'accélération hallucinante de la vieillesse causée par l'effroi. Mis en scène avec précision, accompagné de sons étranges mais pourtant guère inconnus, Kobayashi met en exergue l'infidélité et ses conséquences. Le second sketch, La femme des neiges renvoie aux légendes hivernales superbement adaptées du bouquin original de Lafcadio Hearn par Mizuki Yoko. On y trouve Nakadai Tatsuya dans la peau d'un trappeur perdu au fin fond des dunes enneigées en compagnie d'un co-équipier plus âgé qui succombera d'un sort infligé par une femme mystérieuse venue des neiges. Cette femme, au visage épuré façon Kabuki renvoie immédiatement aux légendes ancestrales par sa teneur et son mystère mais aussi aux fantômes japonais, il existe en effet différentes formes de fantômes, ceux aux visages angéliques et dangereux et ceux repoussants mais particulièrement gentils. Si Kobayashi use du procédé de la beauté trompeuse, c'est pour rendre la rendre fatale et dangereuse comme la mort. Mais la beauté de ce chapitre réside dans son acte purement sentimental ou Nakadai rencontre une femme et lui fait alors trois enfants sans savoir que son épouse cache un mystérieux secret. Monté de façon magistrale par Sagara Hisashi (qui a travaillé notamment sur Hara Kiri) et réalisé avec brio, ce chapitre étonne d'amblé par son cadre hallucinatoire et son ciel parcouru d'yeux ouverts ou fermés, véritable signature visuelle à part entière. L'utilisation de la transparence pour évoquer le spectre se marie parfaitement avec le background et les tempêtes de neige. Notons aussi la belle utilisation de la lumière prouvant que Kobayashi sait aussi parfaitement utiliser la couleur.
S'inscrivant dans le registre particulier du film à sketchs, Kwaidan marqua l'Histoire du cinéma japonais par ses thématiques abordées et son sens aigu de la mise en scène. Récit décousu en quatre histoires différentes, l'accent est mis sur la contemplation au détriment d'une recherche de l'action et de scénarii qui auraient pu gagner en égalité. Kobayashi nous invite avec le premier épisode, Les cheveux noirs à prendre place au sein des différents foyers visités par un homme en plein doute sentimental, visités par ce dernier, lequel finira par revenir en son foyer initial pour reconquérir le coeur de son épouse qui l'attend depuis des mois. Sous ses attraits purement fantastiques, le cinéaste change littéralement de ton, laissant le côté contemplatif et narratif de côté pour une plongée terrifiante dans la mort et l'accélération hallucinante de la vieillesse causée par l'effroi. Mis en scène avec précision, accompagné de sons étranges mais pourtant guère inconnus, Kobayashi met en exergue l'infidélité et ses conséquences. Le second sketch, La femme des neiges renvoie aux légendes hivernales superbement adaptées du bouquin original de Lafcadio Hearn par Mizuki Yoko. On y trouve Nakadai Tatsuya dans la peau d'un trappeur perdu au fin fond des dunes enneigées en compagnie d'un co-équipier plus âgé qui succombera d'un sort infligé par une femme mystérieuse venue des neiges. Cette femme, au visage épuré façon Kabuki renvoie immédiatement aux légendes ancestrales par sa teneur et son mystère mais aussi aux fantômes japonais, il existe en effet différentes formes de fantômes, ceux aux visages angéliques et dangereux et ceux repoussants mais particulièrement gentils. Si Kobayashi use du procédé de la beauté trompeuse, c'est pour rendre la rendre fatale et dangereuse comme la mort. Mais la beauté de ce chapitre réside dans son acte purement sentimental ou Nakadai rencontre une femme et lui fait alors trois enfants sans savoir que son épouse cache un mystérieux secret. Monté de façon magistrale par Sagara Hisashi (qui a travaillé notamment sur Hara Kiri) et réalisé avec brio, ce chapitre étonne d'amblé par son cadre hallucinatoire et son ciel parcouru d'yeux ouverts ou fermés, véritable signature visuelle à part entière. L'utilisation de la transparence pour évoquer le spectre se marie parfaitement avec le background et les tempêtes de neige. Notons aussi la belle utilisation de la lumière prouvant que Kobayashi sait aussi parfaitement utiliser la couleur.
 Hoichi sans oreilles est le segment le plus long de l'oeuvre et sans doute le plus maîtrisé. Kobayashi prend le temps de décomposer son récit en plusieurs parties, l'une débutant sur la bataille entre le clan Heike contre celui de Genji dans les mers de Dan No Ura, entièrement filmée en studio pour un résultat coloré de grande facture, et l'autre racontant les exploits d'un conteur. Toujours accompagnés d'un silence pesant agrémenté de quelques sons métalliques, filmé au ralenti pour appuyer davantage la lourdeur et le tragique des combats (procédé loin des conventions habituelles du cinéma d'action actuel) ce qui se déroule sous nos yeux est d'une maîtrise visuelle sublime, tout comme ce qui le précède et le suit. C'est justement cet accomplissement formel qui donne la force à Kwaidan, cette recherche d'une esthétique inédite, motrice même de la narration. Et cette recherche pousse le film dans ses derniers retranchements visuels grâce aux nombreux sfx insérés à l'écran (la juxtaposition du temple/cimetière) et même si la séquence des oreilles peut paraître ridicule de nos jours, son idée farfelue mérite d'être évoquée. Si le dernier des chapitres est le moins réussi de tous, il reste une petite expérience visuelle sympathique notamment lorsque le noble affronte l'ombre des trois serviteurs du samouraï fantôme, sans réussir à toucher sa cible. En définitive, Kwaidan est avant tout l'aboutissement formel de son auteur, maestria visuelle de tous les instants, resaucée des légendes spectrales du Japon féodal à la Kobayashi, lente et contemplative, délicate mais toujours bluffante.
Hoichi sans oreilles est le segment le plus long de l'oeuvre et sans doute le plus maîtrisé. Kobayashi prend le temps de décomposer son récit en plusieurs parties, l'une débutant sur la bataille entre le clan Heike contre celui de Genji dans les mers de Dan No Ura, entièrement filmée en studio pour un résultat coloré de grande facture, et l'autre racontant les exploits d'un conteur. Toujours accompagnés d'un silence pesant agrémenté de quelques sons métalliques, filmé au ralenti pour appuyer davantage la lourdeur et le tragique des combats (procédé loin des conventions habituelles du cinéma d'action actuel) ce qui se déroule sous nos yeux est d'une maîtrise visuelle sublime, tout comme ce qui le précède et le suit. C'est justement cet accomplissement formel qui donne la force à Kwaidan, cette recherche d'une esthétique inédite, motrice même de la narration. Et cette recherche pousse le film dans ses derniers retranchements visuels grâce aux nombreux sfx insérés à l'écran (la juxtaposition du temple/cimetière) et même si la séquence des oreilles peut paraître ridicule de nos jours, son idée farfelue mérite d'être évoquée. Si le dernier des chapitres est le moins réussi de tous, il reste une petite expérience visuelle sympathique notamment lorsque le noble affronte l'ombre des trois serviteurs du samouraï fantôme, sans réussir à toucher sa cible. En définitive, Kwaidan est avant tout l'aboutissement formel de son auteur, maestria visuelle de tous les instants, resaucée des légendes spectrales du Japon féodal à la Kobayashi, lente et contemplative, délicate mais toujours bluffante.



