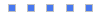ma note
-/5
Merci de vous logguer pour voir votre note, l'ajouter ou la modifier!
Tokyo Bordello
les avis de Cinemasie
2 critiques: 3.38/5
vos avis
6 critiques: 3.67/5
Prisonnières et fausses jouisseuses
Avant d'être une énième excursion dans l'univers des geishas, Tokyo Bordello est une succession impressionnante de tableaux de maîtres réalisés par Gosha et son chef opérateur Morita Fujio tous deux en parfaite fusion, et ce depuis des années. Mais le travail accomplit ici, sous influences du cinéma japonais classique, témoigne d'une perfection qui laisse pantois. Dernier succès au box-office en date pour Gosha Hideo, le film a bénéficié de moyens colossaux afin de reproduire le quartier des plaisirs de Yoshiwara sous la houlette de Nishioka Yoshinobu, non sans une certaine influence européenne dans sa construction extérieure. Le film ne se déroule pas pour autant qu'en extérieur réduit qu'à un simple petit périmètre de rien du tout, les intérieurs sont les vrais éléments de la narration, labyrinthiques, étriqués, mystérieux, dont le luxe ne masque pas l'hypocrisie et la fausseté des geishas désireuses de profiter des plus faibles. La plus faible c'est bien entendu Hisano, nouvelle recrue de la maison, présentée aux trois plus influentes geishas. L'une d'entre elles va d'ailleurs très rapidement s'approprier le corps d'Hisano afin de la préparer au travail. La seule séquence torride du film est une séquence saphique filmée avec un soin tout particulier, la caméra de Morita Fujio effleurant les corps enlacés, comme si Gosha voulait nous dire que seules les femmes ne mentent pas sur ce qu'elles ressentent, car à ne pas s'y tromper, Tokyo Bordello propose une vision une nouvelle fois pessimiste de la gente masculine : les hommes tournent leur veste dès qu'une femme refuse leur avance, ils sont aussi montrés sous un angle oscillant entre la faiblesse et la lâcheté notamment dans la séquence où Kobana, l'une des grandes geishas de l'établissement, se met à péter les plombs en détruisant la chambre d'Hisano, sous le regard simplement médusé et inoffensif des messieurs.


Mais cette vision réaliste du monde des geishas s'accompagne du parcours chaotique d'Hisano, femme prise pour une imbécile, débarquée simplement pour rembourser les dettes de sa famille, mais son succès légitime attire la jalousie et le mépris. Ce propos est une fois de plus doublé par cette sensation de ne pas être dans un quartier des plaisirs, mais plutôt dans une prison ou un supermarché, c'est au choix : étalées en vitrine et présentées comme on essaierait de vendre son poisson frais, les geishas ne sont que de la marchandise, du produit vendu au kilo obligé à se taire pour vivre dans une société qui n'a de l'estime que lorsqu'elles gravissent les plus hauts échelons. Mais combien arrivent à un tel niveau? Combien arrivent à se libérer des liens de leurs proxénètes, après des années de travail? Peu, et ici nous verrons qu'une ou deux geishas obtenir leur liberté. Mais ce métier est paradoxal puisque après ses premiers essais délicats, Hisano prendra plus de plaisir et trouvera une véritable signification et justification à sa "profession". Tokyo Bordello n'est pas non plus une oeuvre optimiste, le dernier plan proprement extraordinaire ruinant tout ce qui a été forgé depuis des années par Hisano, par ce temple du désir et ses propriétaires. D'une vraie beauté triste, Gosha clôt son excursion de bien belle manière.
Le dernier chef d'oeuvre de Gosha
Avec sa trilogie d’adaptations des romans de Tomiko Miyao (Dans L'Ombre Du Loup, 1982, Yokiro, 1983, et La Proie de l'homme, 1985), Hideo Gosha avait atteint une forme de point limite dans la maîtrise de son art, merveilleusement élégant, souverainement classique. Il revient ici dans le monde des geishas et des maisons de plaisir avec un film ovni qui est l’une de ses plus belles réussites.
Gosha endosse les habits du maître Mizoguchi pour nous proposer une peinture très convenue de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tôkyô (fermé en 1957, ici dépeint dans les années 1920). Les situations paraissent en effet avoir été vues mille fois : l’arrivée de la novice, qui vient régler une dette familiale et qui découvre avec les yeux d’Uzbek les mœurs de sa maison, les rivalités entre geishas, les amours, forcément décevantes, avec les clients qu’on espère épouser ou ratisser, l’alcool et l’usure qui conduisent les femmes vers des maisons de moins en moins cotées et vers la prostitution la plus crue… Rien de neuf sous le soleil levant.
Mais quelle virtuosité dans la mise en scène ! Gosha s’éloigne du style classique pour construire un monument baroque, qui oscille en permanence entre son héritage japonais et la modernité occidentale, ne cesse de varier les registres et de tester toutes les formes. Alternance de scènes de chambres avec tatamis et panneaux de fenêtre en papier de riz, filmées en champ contre-champ, et de magnifiques plans séquence de foules, cadrages déroutants (avec une prédilection pour les plongées) et utilisation des couleurs les plus vives avec une maestria étonnante (récurrence du motif rouge pour les héroïnes, du bleu et du vert pour les décors), pittoresques plans paysagers avec soleil couchant et subtils plans de transition entre scène à la Ozu : c’est d’une beauté visuelle permanente et, en dépit de la variété des formes, totalement cohérente. Gosha ose même une scène saphique d’une subtilité et d’une beauté déconcertantes, qui devrait faire périr de honte Abdellatif Kechiche. Jusqu'aux maquillages des actrices (ternes et froids dans la journée, pétaradants de rose, de rouge et de blanc en soirée) et à la musique de Masaru Sato (un thème principal à la Morricone et des variations dans le style de la musique traditionnelle japonaise) qui portent la marque de ce choix délibéré des contrastes, de la mobilisation de toutes les palettes.
Souvent considéré comme un sous-Kurosawa, Gosha vaut mieux que le rang d’excellent artisan où l’on a tendance à le cantonner. Quoiqu’il soit de la même génération que les cinéastes plus reconnus de la nouvelle vague (Teshigahara, Shinoda, Oshima, Yoshida), il apparaît, avec ses films des années 1980, comme le dernier maître du cinéma classique japonais, un cinéma qui n'était pas fossilisé dans ses certitudes mais innovait jusqu'à sa disparition.